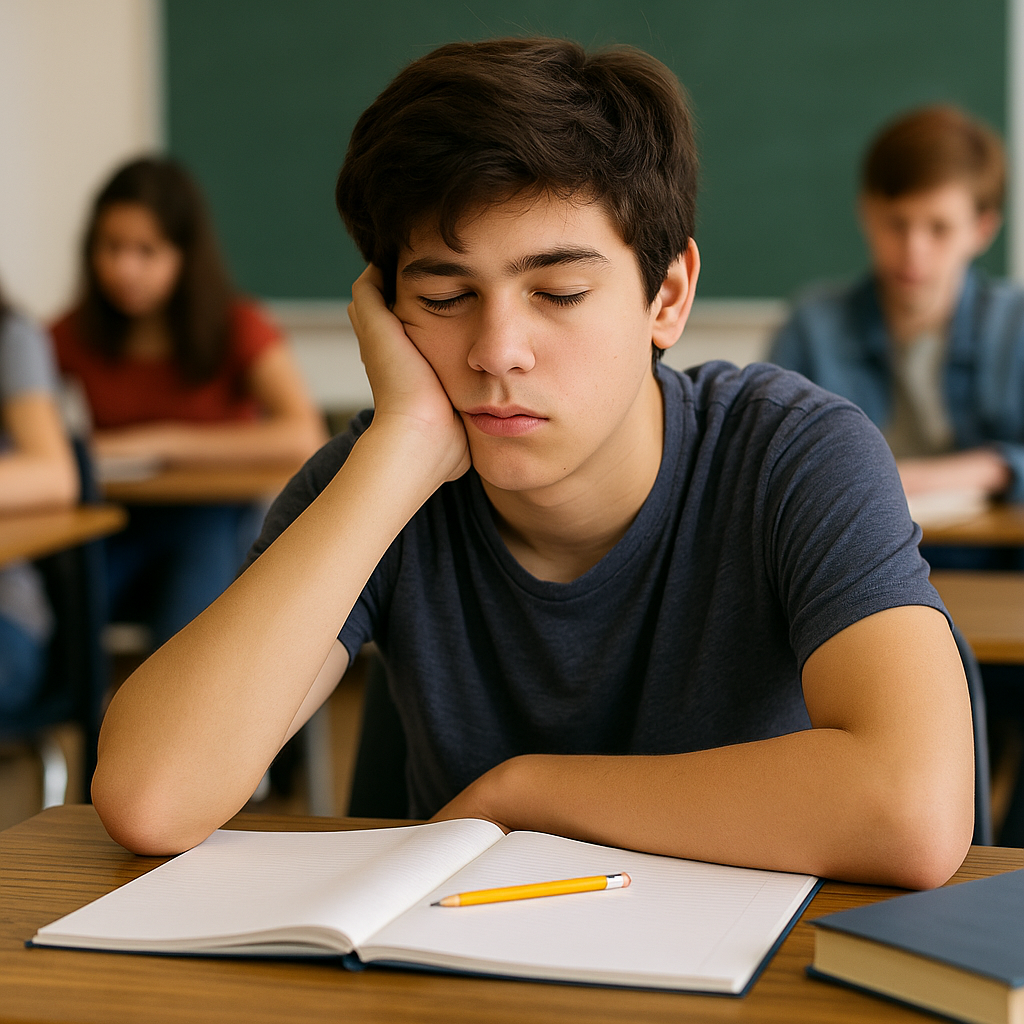Méta-analyse (Altaf & Spiller, 2025)
Pourquoi s’intéresser au sommeil des plus jeunes ?
Le sommeil joue un rôle central dans le développement cérébral, l’apprentissage et la régulation émotionnelle des enfants et des adolescents. Pourtant, une proportion importante d’entre eux dort moins que les recommandations internationales. Selon l’American Academy of Sleep Medicine, les enfants de 6 à 12 ans devraient bénéficier de 9 à 12 heures de sommeil par nuit, et les adolescents de 15 à 17 ans d’au moins 8 à 10 heures. Or, un tiers des enfants et près de 40 % des adolescents n’atteignent pas ces seuils.
Un enjeu majeur est la somnolence diurne : la propension à s’endormir le jour, qui reflète une dette de sommeil nocturne. Celle-ci peut perturber l’attention, l’humeur, la mémoire, et surtout la réussite scolaire. Mais jusqu’ici, la relation précise entre durée de sommeil et somnolence n’avait pas été clairement synthétisée chez les jeunes.
Une méta-analyse pour clarifier les données
Altaf et Spiller (2025) ont conduit une méta-analyse regroupant 17 études internationales, incluant enfants et adolescents (5 à 18 ans). Certaines utilisaient des protocoles expérimentaux de restriction de sommeil (coucher tardif, lever avancé), d’autres comparaient simplement des groupes dormant plus ou moins longtemps.
Les auteurs ont examiné la somnolence diurne évaluée par différentes méthodes : auto-questionnaires, questionnaires parentaux, ou encore tests objectifs comme le Multiple Sleep Latency Test (MSLT), qui mesure la rapidité d’endormissement en journée.
Résultats principaux
- Un effet clair du sommeil court : globalement, un sommeil réduit est associé à une augmentation significative de la somnolence diurne. L’effet est de taille moyenne à forte (taille d’effet standardisée : 0,74).
- Un rôle de l’ampleur de la restriction : plus la différence entre nuits « courtes » et nuits « normales » est grande, plus la somnolence augmente. Par exemple, deux heures de sommeil en moins correspondent en moyenne à une hausse d’1,2 point sur l’échelle de somnolence de Karolinska (KSS).
- Des adolescents plus vulnérables : les adolescents présentent une sensibilité accrue à la perte de sommeil par rapport aux enfants. Cela s’explique par des modifications biologiques liées à la puberté (changements du rythme circadien, diminution des ondes lentes au sommeil, etc.), mais aussi par des contraintes sociales (école tôt, usage des écrans, caféine).
- Variabilité individuelle : les réponses varient fortement d’un jeune à l’autre. Certains deviennent très somnolents avec peu de restriction, d’autres résistent mieux. Cette variabilité pourrait refléter des différences environnementales (hygiène de sommeil, stress, qualité du sommeil) ou biologiques (chronotype, maturation cérébrale) . Certaines études montrent par exemple qu’un début de sécrétion de mélatonine plus tardif est associé à une somnolence accrue après restriction.
Quelles implications pratiques ?
Ces résultats confirment l’importance d’un sommeil suffisant pour limiter la somnolence diurne, elle-même associée à de moindres performances scolaires et cognitives. Ils invitent à :
- Promouvoir des horaires adaptés : retarder l’heure de début des cours chez les adolescents pourrait réduire la dette de sommeil.
- Valoriser la régularité : au-delà de la durée, la constance des horaires de coucher et de lever limite la somnolence.
- Sensibiliser parents et enfants : rappeler que la qualité du sommeil (réduction des écrans, environnement calme, éviter caféine et excitants) est aussi cruciale que la quantité.
Limites et perspectives
La qualité méthodologique des études incluses était globalement faible (échantillons réduits, peu de mesures objectives de la somnolence). De plus, la plupart des études se concentraient sur le court terme.
Les auteurs soulignent la nécessité de recherches futures pour explorer si la somnolence agit comme médiateur entre sommeil court et baisse des performances cognitives. Autrement dit : est-ce vraiment la somnolence qui explique le lien entre manque de sommeil et difficultés scolaires ?
Conclusion
Cette méta-analyse apporte une confirmation solide : moins dormir, c’est être plus somnolent le jour, en particulier à l’adolescence. Mais les variations individuelles montrent qu’il n’existe pas de seuil universel : certains jeunes ont besoin de plus de sommeil que d’autres pour rester vigilants.
À l’heure où la dette de sommeil devient un problème de santé publique, ces résultats rappellent l’urgence d’adapter nos modes de vie et nos rythmes scolaires aux besoins physiologiques des plus jeunes.